Découvrir des séries de tous horizons permet de distinguer certaines tendances qui semblent, dans plusieurs pays à la fois, se dessiner en même temps, sans apparente concertation. C'est agréable, cette impression d'avoir une vue d'ensemble.
Parfois il suffit d'un succès pour contaminer toute la planète, parfois c'est moins facilement traçable. Dans le cas qui nous occupe, ce n'est pas ce qui s'est passé, les projets ayant été lancés en quasi-parallèle. Ce cas qui nous occupe aujourd'hui, ce sont les fictions carcérales.
Encore que ce n'est pas assez précis, pardon : les fictions carcérales avec des femmes.
Si vous le voulez bien, récapitulons ce que les derniers mois nous ont rapporté en la matière des quatre coins du globe :
- Juin 2012 : Dead Boss aux Royaume-Uni
- Septembre 2012 : Unité 9 au Canada
- Mai 2013 : Wentworth en Australie
- Juin 2013 : Orange is the new black aux USA
Seulement 4 séries ? Pas de quoi dessiner une tendance, me direz-vous ! Oui enfin, d'une part, ce sont 4 séries qui sont apparues en un an, dans 4 pays différents, quand il n'y en avait eu les années précédentes dans aucun pays du monde ; et d'autre part... ce post n'est pas fini ! ...Loin de là !
Il y a, certes, à intervalles réguliers, des séries carcérales féminines qui pointent régulièrement leur nez sur la planète ; mais ce sont des phénomènes isolés, quand, pour la première fois depuis longtemps (et en tous cas dans des proportions inégalées), tout le monde semble vouloir SA série sur le sujet.
Parmi les exemples ayant précédé de quelques années cette petite vague carcérale, on peut citer évidemment la mexicaine Capadocia, qui date de 2008 et que je ne saurais que vous recommander une fois de plus d'autant que les deux premières saisons sont sorties en DVD avec des sous-titres anglais, et sont trouvables par exemple sur Amazon.
Je ne suis, au juste, pas à même de dire quel évènement particulier a directement présidé à la naissance de ces séries, de façon quasi-simultanée, s'il y en a un. Par contre, la symbolique et le message de ces séries, que je m'apprête à discuter dans le post qui va suivre, peuvent peut-être servir de piste de réflexion pour expliquer cette curieuse petite mode.
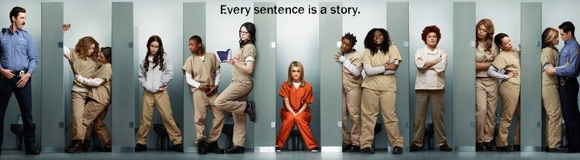 You got that right : orange really is the new black !
You got that right : orange really is the new black !
Mais d'abord, un peu d'histoire.
Le genre du women in prison, car c'est bien d'un genre qu'il s'agit, a connu un boom au cinéma dans les années 60 et surtout 70. Le thème n'était cependant pas tout-à-fait nouveau : on trouve des films women in prison dés les années 20 (les thématiques ne sont toutefois pas explorées de la même façon ; on y reviendra).
En tous cas, l'intention derrière ces films est toujours un peu la même : c'est plutôt le genre de film indépendant qu'on fait sans trop de moyens, et avec l'objectif relativement avoué de montrer des femmes en toute gratuité, dans une configuration "sexy" ou supposée telle. C'est le cinéma sexploitation.
Il y a donc point essentiel à la base de ce genre : tous les prétextes sont bons ! Si une femme se bat (et elle va se battre), ses vêtements seront arrachés ; si elle est sale (et elle va être sale), elle va devoir prendre une douche ; si elle est punie par les autorités de la prison (et elle va être punie), alors elle sera attachée/fouettée/battue de la façon qui sera aussi "sexy" que possible. Les films ne sont pas tous égaux devant cette sexualisation (ni sur la signification de celle-ci), mais elle reste commune au genre.
De surcroît, ces films opposent souvent une femme à la planète entière, ou en tous cas, à tous les humains qu'elle rencontre en prison, ne recevant d'aide ni de la part des geôliers, ni de la part des autres détenues. Car dans ces films, les matons sont souvent brutaux, voire sadiques, et les autres prisonnières le sont à peine moins ; la torture sous diverses formes tient une place conséquente dans l'intrigue, et les prisonnières sont plus généralement soumises à des mauvais traitements injustifiés, genre fouille corporelle, un grand classique ! Le fait que tout ce petit monde vive en circuit fermé n'arrange évidemment rien à l'ambiance.
Il y a des films présentant des exceptions aux caractéristiques que je viens de citer, c'est vrai ; mais au moins un de ces ingrédients est toujours systématiquement présent dans les films women in prison post-révolution sexuelle.
Le contexte de la prison permet aussi de limiter les lieux de tournage, et donc le budget... ce qui n'est pas du luxe vu que la plupart des films women in prison sont, je l'ai dit, de petites productions indépendantes.
Plaît-il ? Un concept pas cher ? Aha, mais ça, c'est une mission pour la télévision !
Au début des années 70, plusieurs séries vont donc reprendre le concept tel qu'il existe à ce moment-là, se l'approprier, et surtout : trouver le succès. A un tel point que le genre women in prison va devenir une manne... pour les soaps !
Ca parait étonnant dit comme ça, tant on imagine que le contexte d'un soap est plutôt inoffensif (à tort), mais si on y réfléchit, ça a du sens : tourner dans un endroit absolument fermé (donc peu onéreux), avec une distribution pléthorique, et avec la possibilité quasi-infinie de toujours rendre la vie plus difficile aux prisonnières (qui de surcroît sont des femmes), eh bien... ça tombe sous le sens quand on connaît le modèle économique et narratif du soap opera.
Les années 70 vont donc voir la naissance de soaps carcéraux féminins à succès.
Dans ces colonnes, j'ai déjà pu citer la série australienne Prisoner. Lancée en 1979, elle s'inspire ouvertement d'une autre série du genre, d'origine britannique cette fois, appelée Within These Walls, et diffusée à partir de 1974 (et ce, alors qu'à l'époque les formats voyagaient moins bien qu'aujourd'hui !). L'originalité de Within These Walls, vis-à-vis des films women in prison, était de s'intéresser non pas aux prisonnières, mais plutôt au personnel de la prison et aux difficultés qu'il rencontrait dans sa mission, ce qui était déjà une innovation en soi par rapport à l'héritage des films. En humanisant les geôliers, Within These Walls se montre déjà plus soft dans ses représentations.
Ces séries vont d'une part être d'importants succès d'audience dans leur pays natal, mais surtout, seront largement diffusées de par le monde.
Diffusée en hebdomadaire, mais en calquant son modèle narratif sur celui du soap, Within These Walls s'achèvera 4 ans après son lancement ; en revanche, Prisoner sera plus longue : elle devait initialement être une mini-série, elle comptera au final 692 épisodes et s'achèvera en 1986.
Pour mieux comprendre l'impact national et international de Prisoner, je vous encourage donc vivement à relire mon post sur l'histoire de la série à travers les décennies. Le post du jour est bien assez long comme ça !
Etonnamment, alors que le phénomène women in prison rencontre le succès à la télévision, en priorité dans le monde anglophone, l'équivalent qu'on pourrait qualifier de men in prison n'existe pour ainsi dire pas, et en tous cas pas dans les mêmes conditions (le genre n'est d'ailleurs pas non plus répertorié au cinéma comme s'inscrivant dans le courant de la sexploitation).
On peut évidemment arguer qu'une fiction carcérale, qu'elle mette en scène des prisonniers hommes comme femmes, a nécessairement tendance à parler de thème violents, et à tenter la surenchère. Je vous l'accorde bien volontiers. Mais "étrangement", les personnages sont plus sexualisés dans le cas des séries féminines. De surcroît, là où le lesbianisme est un thème quasi-systématique des séries avec des femmes, l'homosexualité reste plus marginale dans les séries à population masculine, ou alors elle se limite à des sous-entendus. Pour faire la comparaison, regardez la série américaine Papa Schultz ! Certes elle est un peu antérieure aux soaps women in prison, mais rares y sont les situations explicites...
Il faut préciser à ce propos que les séries carcérales masculines de l'époque sont plutôt des comédies ; c'est le cas par exemple de la britannique Porridge, datant également de 1974. Il ne viendrait pas à l'esprit de grand'monde de torturer les prisonniers jusqu'à ce qu'ils se retrouvent à moitié à poil ! Deux poids deux mesures, comme souvent en la matière.
Je sais à quoi vous pensez et, oui, je vais en dire un mot si vous me permettez cette digression. Vu que je prépare actuellement mon post bilan de la série, on peut se demander si Oz, certes pas du tout contemporaine des séries que je viens de citer, ne tombe pas, ponctuellement, dans la plus basique des configuration propres au cinéma de sexploitation carcéral ; on y trouve après tout de nombreux acteurs montrant leurs fesses ou en full frontal, et une intrigue homosexuelle explicite parcourt une bonne partie de ses saisons. Cependant, la nudité des personnages masculins a-t-elle vraiment la même signification ? Les hommes nus dans Oz expriment des choses très variées, et pas nécessairement l'humiliation sadique qu'on trouve dans la sexploitation. Quand bien même : la série trouve une dimension philosophique et sociale qui permet de lui économiser un label peu enviable, mais il est vrai que dans ses pires épisodes, Oz ne fait sûrement pas mieux qu'un soap carcéral un peu gratuit... Faut-il s'en réjouir ? Ce sera un autre sujet pour un autre jour.
 Les prisonnières de Tenko.
Les prisonnières de Tenko.
Après les années 70, les séries carcérales féminines feront leur apparition sur les écrans de façon plus sporadique, et surtout avec un retentissement moindre. Si j'arrondissais à la louche, je dirais qu'une deuxième vague, ou plutôt mini-vague, enfin un clapotis quoi, est apparue pendant la décennie suivante ; peut-être par effet de bord avec la diffusion de Prisoner qui était en cours, et connaissait toujours un grand succès.
En effet, en 1980, un remake de Prisoner est en projet aux USA ; le pilote de Willow B: Women in Prison ne sera pas retenu, cependant il augure d'une future tentative qui sera plus fructueuse. Mais surtout, deux séries apparaissent pendant cette décennie : d'une part Tenko en 1981 (trois saisons et un téléfilm de réunion), et de l'autre... Women in Prison, diffusée par FOX en 1987.
Ce qui est intéressant avec ces deux séries, c'est leur façon de revenir aux sources du cinema qui a donné naissance au genre, et, en même temps, d'en rompre certains codes, faisant ainsi progresser le modèle.
Ainsi, une grande partie des productions de longs-métrages women in prison revêtaient un caractère exotique : c'est le sous-genre "jungle prison", qui permet de filmer des actrices moites (tout benef'), mais aussi de sembler moins virulent envers le système pénal et d'utiliser une république bananière comme métaphore de la société actuelle. On ne compte plus les films du genre, à partir des années 70, se déroulant dans une prison moite, généralement quelque part en Asie. C'est précisément le choix que fait Tenko, co-production australo-britannique qui se déroule en 1942 après la chute de Singapour, dans un camp d'internement japonais.
Dans cette prison au milieu de la jungle se retrouvent enfermées des européennes capturées par l'armée nippone, alors qu'elles tentaient avec d'autres expatriés de fuir Singapour. Preuve que le choix de l'univers carcéral est au moins autant financier que créatif (la série a vu le jour alors que sa créatrice faisait des recherches sur une infirmière ayant vécu dans un camps similaire), la série sera entièrement filmée dans un entrepôt du Dorset, à l'exception de ses deux premiers épisodes, extrêmement onéreux et filmés on location.
Pourtant, ce qui différencie fondamentalement Tenko du reste des séries sus-mentionnées, c'est que ses héroïnes ne sont pas des criminelles, mais des prisonnières de guerre. Et elles vont non pas se retrouver dans une situation de violence mutuelle, mais s'unir contre leurs geôliers étrangers, du moins dans la première saison (la seconde, située dans un nouveau camps, mettra en scène des femmes "collabos" qui tiennent la prison japonaise ; la troisième mettra l'accent sur leur libération).
Quant à l'américaine Women in Prison, dont on peut difficilement douter vu son titre que ses producteurs ignorent ce qu'ils font, elle reprend le principe très classique de l'innocente injustement condamnée, qui se retrouve dans un univers carcéral dont elle ne connaît pas les codes. Toutefois, et c'est une première pour le genre, il s'agira cette fois d'un sitcom multi-camera. La série n'obtiendra jamais les "back nine", et sera annulée après la diffusion de ses 13 épisodes.
Ces fictions sont des séries hebdomadaires qui s'inscrivent dans leur genre atitré (drama pour Tenko, comédie pour Women in Prison) et s'éloignent du soap.
La toute dernière série anglophone sur le sujet à être diffusée en quotidienne est Dangerous Women, lancée en 1991 en syndication aux USA ; mais il s'agit d'un remake de Prisoner, elle en reprenait de nombreux personnages, des intrigues, et bien évidemment la structure. D'ailleurs le succès ne sera pas vraiment au rendez-vous, et après une saison, Dangerous Women disparaîtra de l'antenne.
En 1999, ce sera finalement au tour de la britannique Bad Girls de reprendre le flambeau, là encore au format hebdomadaire ; jouissant d'une belle longévité, la série durera au total 8 saisons. Les USA ont d'ailleurs envisagé plusieurs d'en faire un remake : d'abord sur FX, puis sur HBO par Alan Ball, et finalement en 2012 sur NBC par John Wells... avant de se raviser. Bad Girls a également été diffusée dans de nombreux pays du monde, bien que souvent de façon incomplète.

Hinter Gittern, le plus littéralement du monde.
En dehors du "triangle" Grande-Bretagne/Australie/USA, les séries carcérales féminines sont inexistantes pendant plusieurs décennies. Dans de nombreuses contrées, le concept de women in prison, s'il est jamais exploité, l'est plutôt au cinéma (indépendant) qu'à la télévision : on compte par exemple de nombreux films du genre en Italie et en Asie (un peu NSFW).
Cela fait moins d'une décennie seulement que les choses ont commencé à changer.
Outre les exemples de Capadocia et Unité 9, plus amplement détaillés dans des posts antérieurs, voici une petite liste de ce que le monde non-anglophone a pu proposer dans le domaine en l'espace de quelques années.
Tout commence avec Hinter Gittern ("derrière les barreaux"), une série allemande qui voit le jour en 2007. Si ses intrigues sont plutôt classiques sur le fond, son cas est cependant un peu atypique sur la forme puisque, bien que la série soit diffusée de façon hebdomadaire, elle emprunte aux codes du soap, rappelant ainsi, encore une fois, combien elle doit à Within These Walls et surtout Prisoner ; elle est, en outre, diffusée sans interruption à longueur d'année, exactement comme de nombreux soaps.
Hinter Gittern connaîtra même des crossovers avec des soaps allemands, plus précisément Gute Zeiten, Schlechte Zeite et son court spin-off Großstadtträume. Lors de ces crossovers, des femmes arrêtées dans l'un des soaps étaient alors envoyées purger leur peine ou attendre leur procès dans Hinter Gittern.
Cette série sera adaptée en Turquie la même année, sous le titre de Parmaklıklar Ardında (une traduction littérale), tournée dans la véritable prison de Sinop qui avait été fermée quelques années plus tôt. La version turque durera 3 saisons, contrairement à la série allemande qui en comportera 16 au total (il faut dire que ses saisons sont découpées de façon assez hors normes).
Jusque là, la Turquie n'avait jamais connu que des mini-séries carcérales en assez petit nombre, évitant de passer trop de temps dans cet univers anxiogène. Elles étaient de sucroît toutes centrées sur des prisons pour hommes, à l'instar de la mini-série Köpek en 2005 (également tournée à Sinop, d'ailleurs). Là où Parmaklıklar Ardında donne dans les thèmes habituels du genre women in prison (évidemment en s'adaptant à la culture turque), Köpek en revanche interroge le cycle vicieux de la criminalité, à travers l'histoire d'un homme né en captivité et qui finit par y passer la plus grande partie de sa vie, devenant ainsi un véritable prédateur. Au passage, vu la réputation des prisons turques depuis Midnight Express, ça doit valoir le coup d'oeil !
Intéressante aussi mais pour une toute autre raison : la série vietnamienne Định Mệnh Oan Nghiệt, diffusée en 2007. Cette fiction offre un twist original à la formule classique : la série commence alors que trois soeurs, orphelines et élevées séparément dans différents foyers ou familles d'accueil, se retrouvent dans une même prison, suite au crime de l'une d'entre elles qui fait boule de neige. Du fait de leur histoire particulière, elles sont à la fois dans une situation classique du women in prison, c'est-à-dire sont seules contre tous (subissant à la fois la violence des co-détenues et celle de leurs gardiens ; de surcroît leur background a aussi des conséquences sur leurs rapports avec la direction de la prison), tout en étant, à l'instar des femmes de Tenko, unies face à l'oppression.
 Jeanne d'Unité 9, l'une des créatures blessées qui peuplent invariablement les séries women in prison.
Jeanne d'Unité 9, l'une des créatures blessées qui peuplent invariablement les séries women in prison.
Oppression, le mot est lâché. Car quelle est, au fond, la symbolique de toutes ces femmes enfermées, série après série, décennie après décennie ?
Le principe de montrer des femmes en prison repose en effet sur une dynamique bien différente d'une prison pour hommes.
Aux origines des films des années 20, le genre women in prison s'appuie volontairement sur un paradoxe, qui sera régulièrement repris par la suite : d'une part, la femme est considérée comme naturellement douce, gentille et sensuelle ; mais puisqu'elle est une mise au ban de la société et qu'elle est considérée comme criminelle, ces qualités sont perverties et elle devient alors violente, malfaisante, et se livre à une sexualité considérée comme plus masculine, c'est-à-dire brutale voire dégradante (ou, dans le cas des films des années 20, elle se livre à une sexualité quelconque, ce qui la dégrade automatiquement).
La sexploitation conduira à une érotisation progressive (bien que pas systématique) de ces thèmes au cinéma, et donc à la télévision.
Il est courant chez la quasi-totalité de ces séries de passer les portes de la prison aux côtés d'une femme qui, elle, au contraire, est bel et bien douce, gentille, et innocente (si possible y compris sur un plan sexuel). Faites le test sur les séries carcérales féminines que vous connaissez !
En fait, c'est bien simple : une héroïne principale de série women in prison est toujours innocente par défaut. Elle a tué ou manqué de tuer quelqu'un ? C'était de la légitime défense : c'est le système qui est bancal. C'est précisément ce que la série a pour vocation de souligner : une femme a suivi les règles du jeu, a quand même fini condamnée, et va maintenant vivre une descente aux Enfers dans un univers auquel rien ne la destinait.
C'est d'ailleurs vrai pour les autres séries qui vont employer l'axe de la femme en prison temporairement, bien que n'ayant pas comme sujet central la vie en prison elle-même. Prenez par exemple Just Cause, série canadienne totalement oubliée (dont je ne me souviens que parce qu'une actrice de la saison 3 de Rude Awakening y tenait le rôle principal). Toute l'histoire repose sur le fait que l'héroïne a été emprisonnée pour un crime qui n'était pas le sien (mais celui de son mari), et qu'elle passe son incarcération à obtenir son diplôme en droit. Elle bénéficie ensuite d'une libération sur parole pour sa bonne conduite, pendant laquelle elle va se démener pour aider d'autres personnes accusées injustement et leur éviter la prison.
Plus occasionnellement encore, certaines héroïnes de séries autrement filmées hors des murs d'une prison, se retrouvent à l'ombre le temps d'un épisode ou moins, comme par exemple Loïs Lane dans Loïs & Clark. Là encore, Loïs est piégée pour un crime qu'elle n'a pas commis, et se débat contre un système qui se retourne contre elle, alors que Loïs est une working girl performante qui a suivi les règles de la société pour s'imposer socialement et professionnellement. Quelle injustice !
Au passage, mentionnons qu'un magnifique hommage aux films women in prison des années 70 sera rendu dans un épisode de Pacific Blue où l'une des fliquettes s'infiltrera dans un pénitentier, se faisant passer pour une détenue ; il est vrai que les dernières saisons de Pacific Blue n'étaient que pure sexploitation à partir du moment où chaque épisode était prétexte à aborder un nouveau fétiche, soi-disant en s'infiltrant dans un nouvel environnement pour mener une enquête, mais cela reste un parfait exemple. Oui j'étais devant la télé dans les années 90, sue me.
On pourrait citer plein d'autres exemples, naturellement. Pour ma part je n'en ai pas vu certains, à l'instar de, attention spoiler pour les retardataires, Weeds, mais je vous laisse le soin d'explorer ces exemples en commentaires ; il y a des chances pour que dans le lot, on trouve des exceptions qui confirment la règle !
Le but du jeu dans tous les cas : voir l'oie blanche (ou l'équivalent de l'oie blanche dans un milieu criminel) lutter contre la tentation de devenir elle-même une créature violente, malfaisante et à la sexualité brutale, la suivre alors qu'elle s'accroche à son innocence... mais, inexorablement, la perd progressivement à travers la réalité de la prison. Pour le plus grand délice sadique du spectateur, comme souvent.
C'est souvent sordide, si l'on y pense. Car la forme-même de la série (et à plus forte raison du soap), contrairement au film, implique qu'une libération n'est pas à envisager dans l'immédiat (plus de prisonnière = plus de série !). Il est dans l'intérêt des scénaristes et donc des spectateurs de faire durer la peine, de ne pas tendre vers une sortie, ni même une amélioration derrière les murs.
L'objectif d'une série carcérale au sens large est de durer, et donc de maintenir la population enfermée dans une situation traumatique ; la surenchère en est une conséquence logique. De ce fait, les séries women in prison n'ambitionnent pas de redresser les prisonnières, ni de faire en sorte qu'une condamnée puisse réintégrer la société, et y trouver une place "honnête" ou en tous cas acceptable.
On l'a dit, les fictions carcérales féminines sont nées dans les années 70, et puisent dans les films d'alors leurs origines. Du coup, rares sont les fictions du genre, y compris aujourd'hui, qui explorent les thèmes des tous premiers films women in prison. Les longs-métrages des années 20 et 30 insistaient en effet sur la réhabilitation, la réintégration de la femme criminelle (ou considérée comme telle par la société) dans une vie plus rangée, plus conventionnelle. Réinsertion était le maître-mot, c'était surtout la méthode qui changeait : si certains films passaient par un pur et simple redressement (presqu'un dressage), la plupart en revanche privilégiaient la notion d'amélioration de la prisonnière elle-même, ou de l'univers carcéral au sens plus large. On retrouve peu ou pas cet ingrédient dans les séries women in prison.
C'est assurément un signe des temps, aussi.
Que les prisonnières se mettent bien dans le crâne qu'elles sont enfermées pour de bon, là où beaucoup de fictions carcérales masculines mettront plutôt l'accent sur l'espoir de liberté ; sans même aller jusqu'à évoquer The Shawshank Redemption, c'est quand même un peu tout le postulat de Prison Break. Dans l'imaginaire de ces fictions, la femme est prisonnière. Enfermée. Il faut la faire plier. Elle va tenter de réagir, de s'adapter... mais pas vraiment de s'échapper : ce n'est pas le propos de ces histoires.
Femme, tu appartiens à tes geôliers, donc. Il dépend de leurs bonnes grâces que tu ne finisses pas tailladée dans la cour ou poignardée dans une douche (et qu'ils soient hommes ou femmes influe assez peu sur leur cruauté, comme le montre l'exemple de Tenko). Le véritable geôlier est le spectateur, naturellement. Les origines "sexploitatives" du women in prison télévisuel sont là pour nous rappeler que c'est là tout le sens que prend l'enfermement de ces femmes, vu qu'il s'agissait d'un cinéma par essence voyeuriste.
D'ailleurs, puisque l'héroïne est innocente (ou victime des circonstances, ou au moins d'une grande naïveté), il n'est donc même pas même pas vraiment question de punir une criminelle, mais de rabaisser une femme qui n'a rien fait de mal d'autre que d'exister dans une société qui lui est défavorable, de la torturer mentalement, émotionnellement, physiquement, et de la pousser dans des comportements sexuels qu'elle n'aurait bien souvent pas choisis à l'air libre (la convoitise, les attouchements et le viol sont, naturellement, très présents dans ces fictions).
Le jour où une série women in prison se sera totalement extirpée du trope de l'héroïne qui est là sans raison valable autre que les injustices, on aura vraiment écarté la dynamique des films notamment sexploitation dans les séries women in prison ; mais pour le moment, ils restent tout de même la plus grande influence sur les fictions télé du genre.
Et il y a une autre bonne raison à cela.
 Capadocia, on s'en lasse pas.
Capadocia, on s'en lasse pas.
Quand une série carcérale féminine veut éviter la gratuité (et c'est de plus en plus le cas reconnaissons-le), la perte d'innocence est métaphorique ; quand évidemment, elle peut être prise de façon plus littérale dans une série plus décomplexée ; rappelons au passage que dans les années 70, les soaps australiens en particulier étaient très chauds (tiens, je vous ai déjà parlé de Number 96 et The Box ? Ah, oui.).
Dans ce cas, il reste toujours l'option de déléguer aux personnages secondaires les intrigues les plus explicites ; là encore, c'est ce qu'ont choisi de faire les séries de l'année écoulée. Et puisqu'on parle de personnages secondaires, eux aussi sont un peu toujours les mêmes : la prisonnière âgée qui s'est adoucie et aide les nouvelles à leur arrivée, l'animal qui n'a presque plus rien d'humain et laisse libre cours à ses pulsions (oh, Bambi), la jeune mère qui s'inquiète pour ses enfants, et ainsi de suite.
Lorsque cette gratuité est évitée pour tout ou partie, la violence décrite prend alors la forme d'une dénonciation sociale.
C'est le but avoué du genre depuis les tous premiers films women in prison des années 20 ; les séries ne font pas exception. Dans son essai "Women in prison movies as feminist jurisprudence", paru dans le Canadian journal of women and the law, la professeure Suzanne Bouclin explique en introduction que :
"certains [films women in prison] offrent des façons d'imaginer la violence de l'Etat et des pratiques judiciaires ainsi que l'inhumanité des institutions de manière à laisser entrevoir des injustices plus grandes de genre, de race et de classe, qui rendent certaines femmes en particulier plus vulnérables à la criminalisation et à l'incarcération."
Comme la plupart des séries carcérales au sens plus large, les séries women in prison accomplissent la même mission, quoi qu'à des degrés variés, et sur des modes qui varient au cours de leurs saisons. A travers des scènes qui peuvent parfois sembler relever de la plus pure et simple sexploitation, les séries carcérales féminines se montrent alors incisives dans leur façon de dépeindre les inégalités sociales auxquelles les femmes font face, et qui les conduisent en prison bien malgré elles.
Le réquisitoire le plus explicite à cet égard est celui de Capadocia ; en choisissant de montrer également ce qui se passe à l'extérieur de la prison, et plus précisément parmi les autorités pénitentiaires, politiques et économiques (...essentiellement masculines), la série met en évidence le "piège" qui s'est resserré sur bon nombre des femmes aujourd'hui derrière les barreaux.
La journaliste mexicaine Marcela Turati met d'ailleurs ce phénomène en exergue dans son article "Capadocia: La realidad que supera la ficción", où elle met en parallèle les personnages et intrigues de la série de HBO Latino, avec le parcours de véritables prisonnières mexicaines qu'elle a rencontrées. Pour elle, les femmes en prison ne sont pas des criminelles mauvaises jusqu'à la moëlle, mais avant tout des femmes fragilisées socialement. Elle cite les statistiques : sur 11 000 femmes incarcérées au Mexique, 96% des sont mères d'au moins trois enfants, 70% n'ont pas dépassé le niveau de l'école primaire, et 20% sont analphabètes. Des chiffres qui n'ont rien de strictement mexicains.
Et de citer le monologue d'un des personnages de la série, l'avocate Teresa Lagos spécialisée dans les Droits de l'Homme, expliquant à un étudiant qui lui demande pourquoi s'occuper des droits des prisonnières :
"Certains crimes sont commis avec préméditation, mais il n'y a pas que cela. Il ne s'agit pas de dire que toutes les victimes sont innocentes, mais qu'une bonne partie des prisonniers qui vivent dans les prisons de notre pays sont emprisonnés pour des erreurs administratives, des défaillances dans le système de justice, parce qu'ils n'ont pas mille pesos pour payer un pot-de-vin. Historiquement, notre société a toujours puni sévèrement les femmes et les épouses. Nous ne pardonnons pas à nos mères, à nos sœurs ou à nos filles ce que nous pardonnons aux hommes de notre famille. La société impose à la femme une responsabilité qu'elle n'a pas demandée. Il est attendu de nous de la soumission, de l'abnégation, et le renoncement à nos désirs, parce que l'homme né de la famille est à la base de la société, et que la femme est à la base de la famille. Mais qu'advient-il lorsque vous supprimez la base de la base ?"
Un sujet exploré plus en profondeur, bien que hors des murs d'une prison, par la série argentine Mujeres Asesinas (adaptée sous le même titre au Mexique, et bientôt aux USA sous le titre Killer Women).
Cette série, dont le format est anthologique, s'applique à montrer des meurtres commis par des femmes que souvent jusque là rien ne prédisposait à la violence. D'ailleurs, la structure-même de la série le met bien en évidence, notamment à travers les titres des épisodes. Ceux-ci portent en effet des appellations suivant le modèle : "Marta Odera, monja" (Marta Odera, la nonne ; c'est le titre du pilote de la version argentine). Si tous les titres ne sous-entendent pas forcément que les femmes assassins sont nécessairement innocentes à l'origine, beaucoup le sont, ou vivent dans une situation compliquée qui en fin de compte les pousse dans leurs retranchements, telle "Felisa, desesperada" (Felisa, désespérée).
Tout n'est donc à jeter dans ces séries carcérales féminines, vous l'aurez compris : loin de là. Cela ne signifie pas non plus qu'elles sont dans la gratuité permanente.
Ces fictions sont capables de dire quelque chose d'intéressant sur la nature humaine ou la Justice, mais aussi sur la condition des femmes dans une société patriarcale. Mais leur concept de départ et la critique sociale qui se trouvent dans ces séries reposent simplement sur une mise en scène généralement plus sexualisée (et pas de la même façon) que pour les séries carcérales masculines.
 "Eylül'de" qui signifie "en septembre", on en a tous profité pour apprendre un mot de Turc dites donc.
"Eylül'de" qui signifie "en septembre", on en a tous profité pour apprendre un mot de Turc dites donc.
Vous pensiez que c'était fini ? Pas franchement. Ainsi que j'ai pu le dire, l'idée n'est pas nouvelle, et ne risque donc pas de disparaître de sitôt.
La preuve avec une fiction carcérale féminine prévue pour la Turquie, et cette fois ce n'est pas un remake : Görüş Günü Kadınları, commandée par la branche locale de FOX, et suivant le destin de quatre femmes emprisonnées ; la série débarque pour la rentrée automnale sur la chaîne.
Et en attendant, je termine de rédiger ma review du pilote d'Orange is the new black. Ah oui ! Parce que je ne vous l'avais pas dit ? Au départ, c'était sur cet épisode que je voulais écrire pour mon post du vendredi...










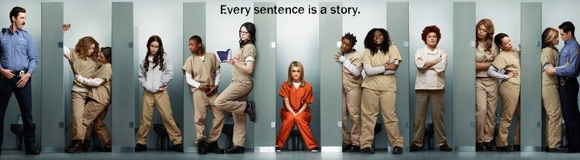











 "C'est comme s'il manquait quelque chose, mais quoi ?!"
"C'est comme s'il manquait quelque chose, mais quoi ?!"


/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F5%2F9%2F59181.jpg)