
Cet après-midi, à Séries Mania, se tiendra un débat sur le thème "Adaptations, remakes et reboots : les séries sont-elles toujours aussi créatives ?", dont vous pouvez lire les problématiques sur le programme de Séries Mania.
Dans la formulation, le point de vue est clairement celui des séries américaines, sous-entendant par là que les séries US (notamment de network ; même si de nombreux projets du câble tendent à relativiser cette croyance ces dernières années) sont particulièrement sujettes au remake, à l'adaptation et au reboot. Du coup, je me suis dit qu'en marge de ce débat, j'allais vous parler... eh bien, du reste du monde, les habitudes ayant la vie dure.
Ces termes sont particulièrement connotés négativement dans notre imaginaire (on leur oppose l'innovation et l'originalité), ce que souligne, d'une façon générale, la formulation choisie pour la présentation de la table ronde. Loin de moi l'idée de prétendre que ces séries ressorties des cartons ou des catalogues des pays voisins sont systématiquement d'une folle originalité, mais cet instinct est peut-être un peu limité : l'adaptation et le remake ont parfois leurs vertus. Et pendant qu'inlassablement on débat de l'originalité de la télévision américaine, on oublie parfois que l'adaptation et le remake sont loin d'être des pratiques propres à la télévision US ; de ce fait, elles couvrent des réalités très diverses.
En effet, aux USA, la reprise de séries étrangères et/ou passées remplace le concept d'acquisition, tandis que dans la plupart des pays du monde, l'adaptation et le remake complètent les politiques d'acquisitions. Cette différence majeure explique que la démarche d'acquérir les droits d'une série pour en proposer une version locale n'a pas forcément les mêmes implications dans le panorama télévisuel d'un pays donné.
Promenons-nous donc parmi quelques adaptations récentes venues des quatre coins de la planète, et observons les différentes réalités qu'elles couvrent.

Apprendre en copiant
Diffusée fin 2012, Obratnaia Storona Luny ("dark side of the moon", les Russes étant moins familiers de Bowie que de Pink Floyd) reprend l'histoire de Life on Mars. Vu qu'assez peu de séries britanniques sont, pour le moment, adaptées ailleurs qu'aux États-Unis, ce cas peut sembler exceptionnel, mais rappelons que la Russie est coutumière des adaptations.
Le pays a, depuis environ le début des années 2000, déployé un goût prononcé (qui a dit douteux ?) pour les remakes. Mais jusque là, le phénomène s'était cantonné aux comédies (nord-américaines) et aux telenovelas (sud-américaines), donnant néanmoins des résultats souvent très probants au niveau des audiences, même si je ne souhaite à personne de voir un épisode de Maia Prekrasnaia Niania, pas même à mon pire ennemi. Cela a conduit les grilles russes à être dominées, pendant plusieurs années, par des comédies et des soaps. C'était vrai à plus forte raison sachant que les séries dramatiques russes ont une nette propension à calquer leur format sur celui des mini-séries (les séries policières, comme souvent, faisant figure d'exception de par leur formule déclinable à l'envi). Les comédies, en revanche, sont inspirées de sitcoms américains ayant aisément franchi la centaine d'épisodes dans leur pays natal, et de telenovelas qui par définition ont également un nombre d'épisodes conséquent, et il y a donc du matériel pour longtemps ; du fait d'une structure généralement peu exigeante en termes de production value, les épisodes peuvent de surcroît être fabriqués "à la chaîne" en un temps record, c'est donc vraiment tout bénef !
En conséquence de quoi, il n'est pas rare qu'en Russie, pour un sitcom, une saison d'une vingtaine d'épisodes soit diffusée en quotidienne pendant quelques semaines, et qu'une autre saison la suive quelques mois plus tard : pourquoi diffuser une saison par an quand on peut en diffuser une tous les 6 mois en bossant vite fait ?
Adapter des formats d'une demi-heure a donc modifié le panorama russe, créant une nouvelle façon de produire (plus d'épisodes, plus de saisons) qui n'était pas dans les habitudes locales plus tôt. Le processus a été décrit dans Exporting Raymond, documentaire qui montre le passage de Tout le monde aime Raymond à la moulinette d'un network russe ; l'expérience a d'ailleurs prouvé que le pilote de Voroniny, l'adaptation en question, n'a pas nécessairement été affligeant, ce qui prouve que le modèle a du bon non seulement d'un point de vue commercial, mais aussi qualitatif.
Bonus non-négligeable, les adaptations russes de sitcoms américains, qui semblent parfois risibles à un regard extérieur (et pas forcément à tort...), ont permis de former une génération complète d'auteurs de télévision russes à la comédie télévisée, qui jusque là, sans en être absente, restait marginale. Grâce à ces copycats, le paysage télévisuel russe s'est transformé ; à force de copier des œuvres originales (avec l'aide, bien souvent, d'auteurs ou producteurs de la série d'origine, faisant alors office de formateurs), la Russie a fait évoluer son marché intérieur.
Depuis quelques années, désormais, la Russie s'intéresse aux formats plus longs, et aux productions dramatiques plus ambitieuses. Ainsi était née, en 2010, Pabieg, adaptation de Prison Break pour Perviy Kanal, et ainsi est née, il y a quelques mois, donc, Obratnaia Storona Luny, toujours sur la première chaîne.
Le cheminement reste strictement le même que celui qui a présidé à la commande d'adaptations de comédies : comme on sort de l'argent pour acheter les droits, ainsi que pour acheter également les scripts clé en main, on s'attend à rentabiliser l'investissement ; adapter des séries dramatiques étrangères se fait donc souvent avec l'espoir de les diffuser sur plusieurs saisons. L'adaptation, en Russie, ouvre donc une fois de plus la porte à des mutations du marché télévisuel national et de ses pratiques, puisqu'en-dehors des séries policières, le renouvellement de séries dramatiques originales était plutôt marginal jusque là. Production coûteuse, Pabieg n'a pas tout-à-fait rencontré le succès espéré, et "seulement" deux saisons ont vu le jour (pas trouvé de trace d'une troisième qui serait en production, et les critiques semblent encourager Perviy Kanal dans ce sens). La raison se logeait dans sa production un peu pauvre comparée à l'originale, et son manque d'intérêt dans le contexte russe.
Ca a vraiment bien marché en revanche pour Obratnaia Storona Luny cet hiver. Le succès de cette série est dû à plusieurs facteurs, inhérents à la question de l'adaptation. Ce n'est pas simplement une question d'acteurs ou de moyens qui a permis l'enthousiasme du public, même si l'acteur principal se débrouille plutôt bien et parvient à faire oublier John Simms (si-si, je vous jure). Ce qui a fait la différence, c'est bien l'équilibre trouvé entre savoir-faire étranger et capacité d'adaptation au contexte culturel de la Russie. Dans le cas d'Obratnaia Storona Luny, repartir dans en 1979 n'a évidemment pas le même sens pour un Russe que pour un Britannique, et la série a dû utiliser les spécificités de l'Histoire russe ; il fallait donc adapter le contexte d'origine à celui, plus complexe, de la Russie soviétique, et cela, le simple achat de script ne peut le couvrir. Obratnaia Storona Luny a donc usé des talents des auteurs russes pour la fiction historique (vaste question, il est vrai) afin d'offrir une œuvre profondément ancrée dans le contexte russe. A partir de là, l'aspect nostalgique (qui a fait le succès de Vosmidesiatye plus tôt en 2012) a sans aucun doute joué. A ce travail de fond s'ajoutait l'apport du savoir-faire britannique : la production a reçu l'aide d'un producteur de la BBC envoyé comme consultant. Le résultat, c'est une série russe qui se place aisément dans le haut du panier des séries dramatiques de par sa production value.
Et cela, il faut le noter, alors que le public russe a déjà vu Life on Mars (sous le titre de Jizn na Marsie), avec des audiences décentes, mais pas épatantes. Ici, clairement, Obratnaia Storona Luny a été un succès (leader de sa case horaire sur Perviy Kanal), et a d'ailleurs été renouvelée pour une seconde saison, même si on ignore pour le moment quand elle sera diffusée.
C'est d'ailleurs le cas de toutes les séries étrangères adaptées par les chaînes russes jusqu'à présent : elles ont déjà été diffusées sur le sol russe par le passé ; on voit bien la différence avec les USA, qui adaptent ce qu'ils savent pertinemment qu'ils ne diffuseront jamais. Et ça n'a pas du tout l'air de déranger les spectateurs russes de voir deux fois des histoires similaires... peut-être parce que, depuis le temps, ce public perçoit que, dans les changements induits par la naturalisation d'une série, on peut trouver de nouvelles raisons de suivre une même histoire.

Le besoin et l'envie
Lancée le mois dernier, Galip Derviş est l'adaptation turque de Monk, sur la chaîne Kanal D (un "derviş", qui se prononce derviche, est un... moine). Ce qui est intéressant en Turquie, c'est que, contrairement à la Russie, le rayonnement des séries turques est indubitable (pour vous en assurer, vous pouvez relire la première partie de ce post). La télévision turque connaît actuellement un véritable âge d'or, et n'a pas vraiment besoin d'adaptations dans ses grilles.
Pourtant, loin de mettre tous ses œufs dans le même copieux panier, la chaîne Kanal D a décidé, en marge de ses séries originales loin d'être dans les choux, de commander un nombre croissant d'adaptations, et d'adaptations de séries américaines de préférence : İntikam (pour Revenge, souvenez-vous), Umutsuz Ev Kadinlari (pour Desperate Housewives, là encore, rappelez-vous, j'avais comparé les deux pilotes) et désormais Galip Derviş, donc, font quelques belles heures de télévision sur le sol turc. Pour l'anecdote, on note très peu d'adaptations de séries autres qu'américaines, à l'exception de 1 Erkek 1 Kadin, versions turque d'Un gars, Une fille (née sur la chaîne du satellite TürkMax, et reprise l'an dernier par le network Star TV).
Ce qui est intéressant, c'est que la Turquie mise avant tout sur des séries "légères" pour ses adaptations : les vraies séries dramatiques, les créations originales s'en chargent. Par contre, quant il s'agit des comédies, des dramédies et des primetime soaps, là, ok, on veut bien prendre des concepts étrangers. En gros, les Américains, on les aime bien, mais pour divertir la famille au sens large et/ou les ménagères ; pour des séries complexes, des reconstitutions historiques méticuleuses, des dramas sombres et des thrillers virils, on va se débrouiller nous-mêmes avec nos scénaristes, merci, on a tout ce qu'il nous faut.
Une position originale, sachant qu'il est généralement moins facile d'adapter des comédies et de trouver le succès (problème d'humour culturel) : dans une majorité de pays de la planète, un remake de comédie américaine est souvent voué à l'échec en termes d'audiences. Qui plus est, quand on sait que les Turcs produisent déjà plein de soaps à succès, qui eux-mêmes se regardent dans toute la région, voire plus, on ne peut pas dire que les chaînes turques soient à la traîne de ce coté-là, ni aient besoin d'aller acheter les scripts des copains.
Alors pourquoi le faire ? Explication en trois étapes :
- à la différence des Russes, les Turcs pourraient très bien se passer d'adaptations, donc. Mais les séries étrangères sont jugées divertissantes (avec une dimension peut-être légèrement péjorative), au sens où un spectateur turc n'attend pas grand'chose d'une fiction américaine. Ça se regarde sans y penser, quand le public a tendance à s'investir dans une série nationale ;
- à la différence des Russes également, les Turcs ne tiennent pas avec ces remakes leurs plus gros succès d'audiences, et s'accommodent fort bien de cela ; à titre d'exemple, Galip Derviş est diffusée trois fois par semaine (un inédit le jeudi à 23h, rediffusé ensuite le samedi après-midi et le dimanche matin) ; la série permet en outre à Kanal D de proposer une fiction originale sans redouter de se faire écraser par la grosse production que la chaîne publique TRT1 diffuse le jeudi soir à 22h50, Şubat, et qui attire un public plus exigeant : l'échec est moins cuisant si l'investissement initial est minime.
- enfin, à la différence des Russes encore, le public turc n'a pas souvent vu la série d'origine ; Revenge n'est par exemple pas encore diffusée en Turquie, et vu que désormais c'est par İntikam que les spectateurs turcs ont pris connaissance du revengenda, il y a fort à parier que ce n'est pas pour tout de suite. Ou comment un network américain très désireux de vendre des droits d'adaptation à tout le monde (jurisprudence Desperate Housewives) a trouvé le partenaire parfait avec une chaîne turque désireuse de ne rien diffuser d'étranger en primetime.
Conclusion : les adaptations de séries étrangères sont, en fin de compte, plus ou moins des projets "bouche-trou" : ils font des audiences décentes, mais pas explosives, et on ne leur en demande pas tant de toute façon. Ils sont là à la fois pour offrir une programmation non-importée facile à produire (le travail de développement étant simplifié, par définition) et facile à diffuser à peu près quand on veut. Ça coûte peu cher, c'est flexible, ça a fait ses preuves, et de toute façon, le public ne s'y attachera pas, c'est juste pour passer le temps.
Les adaptations, les Turcs n'en ont aucun besoin. Mais il semblerait que le public en ait envie, pour varier leur menu télévisuel, et pour les chaînes, ces mêmes adaptations servent de tampon dans les grilles. C'est aussi simple que cela.
Dans le cas de Galip Derviş, la production turque reprend les ingrédients, jusque dans l'accompagnement musical, de la série Monk. Le copier-coller est flagrant (et évidemment assumé), à une nuance près : la version turque dure 90 minutes, comme toutes les séries turques...

Refaire pour comparer ?
Dans le domaine de la comédie cette fois, parlons d'Aaf!, l'adaptation aux Pays-Bas du sitcom Rosanne, sur RTL4. La chaîne néerlandaise n'en est pas à son coup d'essai en la matière : il y a quelques mois, elle avait par exemple lancé Golden Girls, l'adaptation, vous l'aurez deviné, de la série américaine des années 80 quasi-éponyme. Par le passé, elle a également adapté Tout le monde aime Raymond sous le titre Iedereen Is Gek Op Jack ; chez RTL Boulevard (on reste en famille, donc), on ambitionne d'ailleurs d'adapter La croisière s'amuse dans un avenir très proche.
Sur le papier, Aaf! est tout ce qu'on redoute dans une adaptation d'un sitcom américain commençant légèrement à prendre de l'âge : une comédienne locale connue (Annet Malherbe, que les spectateurs français ont eu l'occasion de voir dans la série Gooische Vrouwen, alias Jardins secrets) à qui on offre un rôle qui a fait ses preuves et que tout le monde connaît. Le résultat est généralement kitschissime, car il n'est pas rare qu'au nom de la prétendue identité de la série originale, ou, au mieux, au nom de la nostalgie, la nouvelle série ressemble à s'y méprendre à la série originale, en dépit du fait qu'elles aient plusieurs décennies d'écart. Golden Girls, la série néerlandaise, avait exactement ce tort, qu'avait également la version espagnole, La Chicas de Oro (un gros bide pour La 1 en 2010) : pourquoi refaire une série des années 80 à l'identique quand des rediffusions suffiraient ?
La différence, c'est peut-être qu'Aaf! est une adaptation intelligente d'une série qui ne l'était pas moins. La version néerlandaise (qui est à l'heure actuelle le seul remake officiel de la série Roseanne de par le monde) ne cherche absolument pas à faire mine de se dérouler dans les années 80/90, le pilote commençant même par une dispute entre les enfants autour de l'ordinateur, des réseaux sociaux et d'un iPhone, histoire de mettre les choses au point très vite. L'idée motrice de cette adaptation est avant tout de reprendre le sujet de Roseanne, et non son identité au sens strict, et ainsi de suivre les Jansen, une famille modeste... mais pas ouvrière. Eh oui, les réalités ayant changé depuis 1988, l'héroïne ne travaille plus sur une chaîne de montage, mais dans un call center. Les problèmes rencontrés par Annet Jansen et les siens sont les mêmes, touchant les spectateurs de la classe moyenne directement dans leur quotidien. Résultat : excellentes audiences, et surtout, la preuve qu'une adaptation n'est pas obligée de singer l'original.
Roseanne était une série engagée ? Le processus par lequel Aaf! a pris sa forme finale, et la comparaison entre l'original et l'adaptation, le sont tout autant : pour les classes très moyennes, tout change, et rien ne change. La crise reste la crise.

Valeur ajoutée
Un cas de figure que nous n'avons pas encore abordé est celui du remake à l'intérieur-même des frontières (qui est certainement le plus lourd reproche adressé aux séries américaines s'y risquant). Le Japon, parmi quelques autres, est friand de ce procédé, et l'a montré de façon plutôt éclatante ces derniers mois avec Tonbi, un roman de Kiyoshi Shigematsu publié en 2008, dont deux adaptations différentes ont été diffusées à un an d'intervalle sur les écrans nippons.
Tonbi, l'histoire d'un père très modeste qui élève seul son jeune fils à qui il veut offrir le meilleur, emprunte toutes les recettes d'un drama familial émouvant et optimiste. Mais il se double aussi d'une dimension historique puisque tout commence dans les années 60, alors que le fils a trois ans ; l'histoire suit celui-ci jusqu'à l'adolescence.
En janvier 2012 d'abord, la NHK propose un tanpatsu (un téléfilm, ou téléfilm en deux parties dans le cas présent), qui trouve un succès critique incontestable ; c'est tout-à-fait le genre de séries que propose volontiers la chaîne publique, et qui lui confère son excellente réputation en matière de séries, bien que les audiences ne suivent pas toujours.
C'est le cas ici, car assez peu de spectateurs japonais ont regardé les deux volets, en dépit d'une diffusion à une heure de très grande écoute, le samedi à 21h. Il n'empêche : salué pour sa qualité, le Tonbi de NHK (photo ci-dessus) va faire une jolie carrière internationale, et obtiendra d'ailleurs le prix de la Meilleure mini-série au festival de Monte-Carlo quelques mois plus tard.
Le succès à la fois du roman, mais surtout de l'adaptation qu'en fait NHK, n'échappe pas à TBS, qui met en chantier séance tenante sa propre adaptation, avec la rapidité propre à l'industrie télévisuelle japonaise. Rappelons que tous les trois mois, les chaînes japonaises changent intégralement leurs grilles de fictions (à l'exception de deux cases horaires pour la NHK qui ont respectivement un rythme semestriel et annuel), et lancent donc de nouveaux projets de séries tous les trimestres. Lancer un remake en un temps record ? Ça n'a rien d'une exception. Moins friande de tanpatsu familial, TBS opte de son côté pour un format plus classique, le renzoku : une dizaine d'épisodes diffusés hebdomadairement pendant la saison hivernale, de janvier à mars 2013, donc, le dimanche à 21h, case convoitée s'il en est, et parmi les rares dans les grilles japonaises à mettre en concurrence plusieurs fictions.
A ce stade on pourrait penser que le public japonais, qui n'avait pas accroché en masse à la première adaptation de NHK, ne va pas tellement se précipiter pour assister au remake. C'est oublier que la machine TBS connaît son affaire : le cast est irréprochable, le générique de sa version de Tonbi est interprété par un chanteur très populaire, et ainsi de suite, bref tout est fait pour attirer un large public... et c'est effectivement ce qui se produit, avec des audiences deux fois plus importantes que pour le Tonbi de NHK dans une case pourtant plus difficile ! Le public est venu en masse, mais encore fallait-il le garder ; ça a été le cas, et même mieux : au termes de la diffusion, le 10e et dernier épisode a rassemblé 20% des parts de marché, un score devenu rare à la télévision nippone. Avec Tonbi, TBS a tenu son plus grand succès de la saison, avec une série qui n'avait rien d'inédit, mais qui, par la bonne combinaison de marketing intelligent et, évidemment, de qualité, a su toucher les spectateurs... D'ailleurs, la version 2013 de Tonbi a décroché deux récompenses aux Nikkan Sports Drama Grand Prix (un prix décidé par le vote des lecteurs de la revue Nikkan Sports), il y a quelques jours : un comme Meilleure Série, l'autre comme Meilleur acteur pour Masaaki Uchino.
En fait, TBS a démocratisé la recette initiale de Tonbi : sans en dénaturer les qualités, la chaîne s'est appropriée le sujet pour en faire un vrai rendez-vous grand public, quand celui-ci était passé à côté d'une première version plus confidentielle. Une jolie vertu pour un remake, non ?

Traitement local
Mais ces dernières années, le champion toutes catégories de l'adaptation, c'est BeTipul. Les autres séries peuvent rentrer chez elles, il n'y a pas de match.
Le drama israélien a été adapté dans une liste de pays longue comme le bras : les États-Unis, bien-sûr, avec In Treatment sur HBO (ce qui a permis à HBO Central Europe de sortir quatre versions locales, dont Terápia en Hongrie, et În Derivã en Roumanie), mais aussi aux Pays-Bas avec In Therapie, au Brésil avec Sessaõ de Terapia, en Argentine avec En Terapia, ou, plutôt sympathique pour nous autres francophones, En Thérapie au Québec. La liste est loin d'être exhaustive, et ça donne la montage ci-dessus, avec une tripotée de thérapeutes aux quatre coins de la planète, et je ne compte même pas les patients. Et je vous dis ça sans compter Shinryouchuu, version japonaise "inspirée de" BeTipul (traduction : j'ai pas voulu payer pour les scripts), tournée sur le monde du lycée.
Dernière victime en date de cette épidémie : l'Italie, qui s'y colle depuis quelques semaines sur Sky Italia, avec... In Treatment, parce que pourquoi faire compliqué ?
La tactique adoptée pour la revente des droits par les Israéliens est assez différente de celle de la plupart des séries : il s'agit de chercher des interlocuteurs à portée limitée (chaînes du câble ou du satellite, par exemple ; ou dans le cas du Québec, à portée locale et non nationale), de façon à maintenir une certaine demande : la série est bonne, mais elle n'est pas facilement accessible dans une région donnée. Mieux que ça encore : le format ne coûte rien à produire (pour schématiser : un canapé et un fauteuil, et on est partis), est déclinable à l'infini dans une grande variété de langues (la preuve). BeTipul n'a, de surcroît, presque jamais été diffusée à l'étranger (il me semble qu'une obscure chaîne câblée diffusant des programmes en hébreu l'a montrée aux USA, mais je vous dis ça de mémoire), et mise sur le fait que personne ne peut/veut acheter les droits de diffusion. De ce fait, pour les pays dans lesquels elle est adaptée, la série fait figure d'inédit total.
Il faut dire que non seulement son sujet, mais sa structure également, s'accommodent assez peu des contraintes des grandes chaînes. Même si l'on met de côté son aspect claustrophobique pas franchement avenant pour le très grand public, le format de BeTipul repose sur une série d'entretiens diffusés de façon quotidienne : du lundi au jeudi, le personnage du psy reçoit ses patients, et le vendredi, c'est lui-même qui suit une thérapie. Combien de grandes chaînes se lanceraient dans pareil défi à une heure de grande écoute, à un échelon national, et en quotidienne ?
D'autant que le cahier des charges de BeTipul est d'une inflexibilité incroyable : à l'instar de la plupart des séries israéliennes adaptées à l'étranger, la production est très regardante dans ce qui est fait dans chaque pays adaptant les droits, et il est frappant de constater à quel point les diverses versions reprennent tous, plan par plan, le même schéma. Les scénaristes locaux ont une marge de manœuvre extrêmement limitée.
Mais malgré la rigidité apparente de son principe comme de ses modalités, BeTipul, c'est aussi une série extrêmement adaptable, tout simplement parce qu'il est très simple de modifier un seul personnage pour lui donner une couleur locale. Ainsi, dans la version originale, l'un des patients de la première saison est un soldat israélien impliqué dans le conflit palestinien ; dans la version américaine, ce même soldat devient un GI qui a fait l'Irak. Dans le In Treatment italien, il n'y a plus de soldat, mais un policier travaillant en immersion sur une affaire mafieuse, et ainsi de suite. A côté de ce personnage, le couple en crise ou l'adolescente suicidaire sont suffisamment universels pour ne pas nécessiter l'intervention lourde de scénaristes dans les pays adaptant la série, ce qui simplifie d'autant le processus d'adaptation et donc de développement.
Contrairement aux exemples précédents, les multiples adaptations de BeTipul ne s'insèrent dans aucune tendance, aucune mode dans un pays donné : c'est l'inverse. Le drama israélien est celui qui part à la conquête de la planète, et non le produit qui vient combler un besoin. Le besoin est créé autour de la série, de son procédé original, de son ton unique, et n'est pas déclinable au-delà de la seule franchise BeTipul par les chaînes qui en font l'acquisition.
L'adaptation et le remake sont-ils pure paresse ? Ce n'est donc pas toujours si simple. Osons le dire, parfois, les remakes, adaptations et reboots ont même carrément du bon...































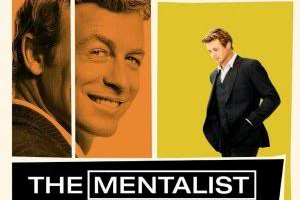




















































/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F5%2F9%2F59181.jpg)