Non-identifiée
"A quel personnage t'identifies-tu le plus ?"
C'est une question qui est régulièrement posée dans toutes sortes de discussions à teneur téléphagique. Mais je n'ai jamais de réponse. Je n'en ai jamais eu.
Ce qui s'en approche le plus pour moi, c'est de citer des personnages qui m'ont servi de modèle ou d'idéal à un moment donné, notamment vers la fin de l'adolescence. Mais je ne m'y reconnaissais pas, et ça ne m'a jamais effleurée.
Ca n'a jamais été un problème à mes yeux, d'ailleurs. Mais j'ai souvent observé que de nombreux téléphages, et quasiment tous les télambdas, cherchaient au contraire à s'identifier à des personnages ou des situations pour pouvoir les suivre, et c'est définitivement la différence que je ressens comme étant la plus prononcée dans ma façon de vivre ma téléphagie et celle de la plupart des gens que je connais.
Je ne regarde pas de la fiction pour qu'on y parle de moi, ce n'est pas ce que je recherche ; j'y cherche et trouve aussi bien du divertissement que de l'émotion brute, un exercice de style qui me permet de découvrir des thèmes originaux sur le fond ou une façon originale d'innover sur la forme, et je suis en quête, dans mes visionnages, d'énormément d'exotisme, pas juste au sens géographique (cette donnée-là dans ma consommation est plutôt récente, comparativement), mais au sens où regarder la télévision, depuis toujours, et aussi cliché que cela puisse paraitre, est pour moi une fenêtre sur le monde. L'idée est d'essayer de se glisser dans la peau d'un personnage qui mène une vie qui ne soit pas la mienne, et qui m'offre une opportunité de ressentir par procuration des choses que je ne vivrai jamais (et le plus souvent : tant mieux !), pas de trouver un personnage qui exprime des choses dans lesquelles je me retrouve. Les personnages qui m'intéressent sont ceux avec qui j'aurais envie de discuter dans la vraie vie, pour échanger des impressions ou des expériences, pas ceux qui me renverraient un miroir, car j'ai l'insupportable prétention de croire que je suis capable d'introspection sans ça.
Je regarde des séries pour savoir, pendant 45 minutes en moyenne, ce que c'est que d'être une mère de famille nombreuse mariée à un pasteur, le héros d'une guerre qui se déroulera quand j'aurai 82 ans, et une actrice sur le retour alcoolique. Et quand l'épisode est fini, je reviens à ma vraie vie, à mon vrai moi, et je me sens enrichie par ces expériences dans ma compréhension du monde et des gens, même de façon minime (ou carrément illusoire, car parfois, juste parfois, une série n'est jamais qu'une série).
L'absence d'identification n'a jamais été un problème à mes yeux. Cependant j'ai bien observé que c'était une position moyennement partagée, et que la plupart des téléphages cherchent au contraire l'identification, que c'est même une nécessité pour s'intéresser au sort d'un personnage.
C'est encore plus prononcé pour les publics adolescents, d'après mes observations. Et quelque part je le comprends, même si je n'en ai jamais fait l'expérience, parce que c'est une période où on a envie de penser qu'on n'est pas seul à faire certaines expériences, où on essaye de calibrer notre comportement sur une norme, et que les séries participent à cette norme à divers degrés.
Quand j'étais adolescente, la télévision était physiquement difficile d'accès en la présence de mon père, de sorte que lorsqu'il était au boulot, ma mère nous laissait nous jeter sur la télévision comme des affamées, et on regardait n'importe quoi qui soit diffusé pendant le créneau horaire. Et j'ai grandi à une époque où ces créneaux horaires étaient majoritairement occupés par des séries. C'est aussi simple que ça. Si j'avais eu 100% Mag à la télévision à l'époque, eh bien aujourd'hui peut-être que je suivrais la dernière tendance de scrapbooking à partir de boîtes de camembert, et on ne serait pas là à parler séries.
Je ne suivais pas de série en particulier parce qu'on n'était pas en position de faire des plans sur l'avenir, et les horaires de mon père étant ce qu'elles étaient, on n'était jamais sûres de regarder le lundi la suite d'un épisode diffusé le vendredi, mais globalement, il y avait quand même des séries qui avaient nos préférences, même dans ce contexte.
L'une d'entre elles était Angela, 15 ans. C'était la seule teenagerie que je regardais à l'époque. Plus tard, je suis passée à côté de Dawson, notamment, qui ne m'a jamais intéressée mais qui semblait émouvoir toute ma génération. A partir de là, c'était quand même bien foutu pour moi, j'ai quitté le nid familial pour aller vivre ma vie, et les histoires adolescentes m'ont encore moins captivée, même si je me suis intéressée à Coeurs Rebelles (surtout pour les histoires de viol et de drogue, soyons honnêtes) ou La Famille Green (que j'appréciais énormément pour y suivre trois générations de la même famille), donc pas vraiment en terrain adolescent au sens strict.

Cet après-midi j'ai revu plusieurs épisodes d'Angela, 15 ans, et cela faisait quelques années qu'une telle chose ne s'était pas produite. Comme je viens d'avoir 30 ans, et qu'à un ou deux ans près, j'avais alors l'âge d'Angela Chase, je pensais que je m'étais peut-être identifiée à elle et qu'en revoyant la série, j'allais retrouver l'adolescente que j'étais, ses émotions, ses questions.
Pas du tout. En regardant les épisodes, je me suis souvenue, de façon à vrai dire assez brutale, de ma propre adolescence ; c'était probablement un mécanisme de mémoire étrange qui me ramenait des images et des anecdotes de cette époque, par association d'idée ou quelque chose, je ne sais pas. Mais en tous cas ces souvenirs n'avaient rien de commun avec les expériences d'Angela, ou de ses amis ; non plus que ses relations avec ses amis, ou ses rapports à ses parents, ou même à sa frangine. Et ne parlons même pas de Jordan Catalano.
Je trouve toujours qu'Angela, 15 ans est la série adolescente la plus réaliste que je connaisse ; lors d'un débat, je ne sais plus qui m'avait dit, une fois, que c'était générationnel. Mais visiblement non, je ne m'y suis pas reconnue, et cette série n'était pas ma réalité. Et c'est certainement pour ça qu'elle compte parmi les rares séries adolescentes que je tiens en estime, parce qu'elle arrive à me sembler authentique malgré l'absence d'identification. Téléphagiquement, c'est ce qui fait sa valeur.
Mais humainement ? Cet après-midi, j'ai trouvé très triste de ne même pas être capable de m'identifier à Angela, 15 ans.
Si je n'y arrive pas avec cette série-là, alors avec laquelle ?
Alors ça m'a renvoyée à mon absence d'identification, et à mon problème avec les séries adolescentes en général. Est-ce que par hasard ces deux phénomènes seraient liés ?
Je n'ai jamais compris l'attrait de Dawson auprès des adolescents de ma génération (parmi lesquelles, notablement, mon ex petit-ami de l'époque). Par la suite, j'ai trouvé Skins, qui pourtant semblait parler aux adolescents de sa génération, très extrême et superficielle ; je me suis dit que j'étais simplement trop vieille pour que ça me parle et je suis passée à autre chose. Je n'ai pas insisté. Et la plupart des séries adolescentes, notamment Gossip Girl que j'utilise toujours comme exemple du pire, me semblent toujours mauvaises.
Ce soir j'ai aussi regardé le pilote de Clash, et là encore, j'ai trouvé que c'était un peu n'importe quoi, une sorte de fantasme de l'adolescence complètement déconnecté des vraies problématiques. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi, des vraies problématiques d'ados ? J'ai 30 ans ! Alors peut-être que Clash voit juste, en réalité...
Et si au fond, le problème était simplement que je ne me retrouve pas dans ces personnages ? Que je n'ai trouvé aucune série adolescente qui me parle de l'adolescente que j'étais ? C'est peut-être ça, l'origine de mon soucis avec les séries adolescentes. C'est que je n'en trouve pas qui me parle de moi.
Il n'y a qu'une façon de régler ça : trouver une série avec un personnage auquel je m'identifie. Je ne sais pas si cette série existe. Je ne l'ai jamais cherchée. Mais ça ne m'attire pas du tout de me mettre à sa recherche, en fait.
Vous savez quoi ? Dans le fond, je préfère continuer à aller chercher des personnages qui ne me ressemblent pas, plutôt que de tenter de me réconcilier avec les séries adolescentes.
Mais je suis contente d'avoir l'opportunité de me poser ce genre de questions rien qu'en regardant des séries. Et finalement, c'est peut-être ça que je cherche le plus dans ma téléphagie.





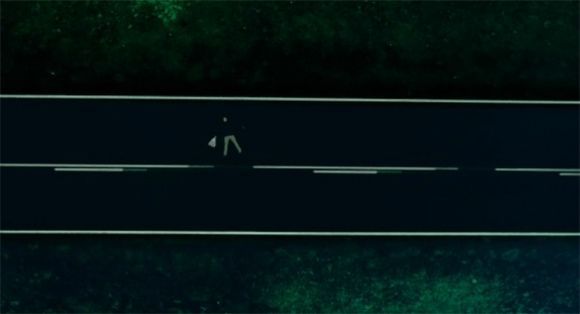




































/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F5%2F9%2F59181.jpg)